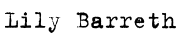C’est dans sa boutique de Nancy, consacrée aux jeunes créateurs,que Lily Barreth entreprend à l’origine de rapprocher l’art de la mode. Cette expérience la conforte dans ses recherches et dans sa volonté de développer une nouvelle proposition fondée sur un autre rapport au vêtement. En 1987, son sens artistique la pousse à créer sa propre collection: Lilith est née.
De son travail dans la mode, elle déclarait alors:
“En chacun de nous vivent de multiples potentiels cachés, émotionnels. Ces fragments souvent hétéroclites, indépendants et liés à la fois, tissent notre personnalité. Ils se révèlent, s’ensommeillent, disparaissent, surgissent à nouveau. Ils irriguent notre vie et nous lient les uns les autres. Ils fondent notre humanité. La mode est un art mineur. Comme tout art mineur, elle est proche de notre quotidien, de notre expérience et intimement liée à notre vie.
Comme tout art, il lui appartient de nous aider à révéler et exprimer ces potentiels cachés. J’ai voulu pour Lilith retrouver notre innocence, considérer le corps dans son mouvement, jouer avec le vêtement, s’habiller pour se découvrir, exprimer notre recherche humaine, notre liberté, dans le jeu des matières et des formes, des alliances inattendues, des détails singuliers, des volumes et des couleurs, au travers d’une autre mode, d’un autre plaisir.”
En se retirant du monde de la mode aujourd’hui, elle ouvre un autre chapitre de son histoire en poursuivant son travail créatif dans la peinture et une recherche exigeante dans le monde de l’art, une raison d’être…
D.R.
Peindre le mur
Peindre, c’est affronter un mur, autant dire s’aventurer à la surface. Il y faut une certaine force, accepter de l’affronter afin de faire apparaître du jamais vu, et ce n’est pas là l’“autre côté du miroir”, bien au contraire faire émerger l’image, le simulacre, l’effet prodigieux des matières. Peindre pour Lily Barreth est la confrontation à ce mur, construire un chemin sur ce mur, l’inventer.
Travailler cette surface, est une lutte contre l’idée de profondeur, mais aussi un thème paradoxal lié à l’intériorité, à son histoire personnelle même. Longtemps l’histoire de la peinture a été confondue avec la question de la veduta, cette fenêtre ouverte sur le monde. Pour la peintre cette valeur de la peinture est comparable à la traversée de cette fenêtre pour mieux se retrouver face au mur (Wand), comme une réponse à l’habit (Gewand) qui traverse son histoire, à ce qui fait sens et qui revient par la fenêtre, le tableau.
–
Redonner la profondeur à la surface comme l’habit donne volume et présence au corps. Le mouvement, le temps sont dans le vêtement, ils sont également dans le geste de peindre. Faire l’habit c’est le faire à plat pour le transformer en mouvement par le corps; peindre c’est prouver le mouvement dans le jet sur la surface, irriguer la toile par la matière, contraindre la structure de celle-ci par les textures répandues, tout est dirigé, réglé, cadré. Mais la peinture est muette, ce qu’elle refuse ici, c’est la profondeur (au sens métaphysique, ontologique), la surface doit à tout prix faire percept, sensation, faire son œuvre de contemplation en réinventant un désir.
Mais qu’en est-il du faire dans ce jeu? Il y faut tout un travail de documentation, par la recherche iconographique sur la peinture (car comment peindre sans une reconquête du déjà-là ou du déjà-peint?), la photographie de murs (car comment exposer le mur sans le posséder?), pour créer l’événement peinture/tableau. Il faut faire émerger l’émotion violente et l’irruption chez le spectateur.
–
Irruption qui nous confronte au mur, recherche patiente d’une science de la platitude qui nous oblige à suivre les rencontres entre les couleurs, les formes, suivre la frontière des lignes qui courent à même la toile, le cadre. Cadre, il s’agit aussi de cela, qui permet au regard d’aller à ce qui est invisible, ou rendre enfin visible le mur. Car la peinture est difficile, par son bord, car elle veut dire que les choses du monde sont coupées, mutilées, divisées, scindées, fêlées, fendues, arrachées au mur.
Notre émotion vient de là, une fêlure qui rend la peinture de Lily Barreth consubstantielle à notre condition humaine.
Proust a encore ici raison: “Nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre nous pouvons entre les deux établir une concordance mais non combler l’intervalle.”